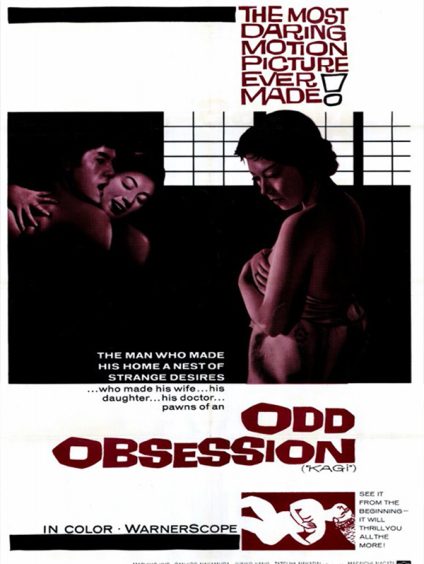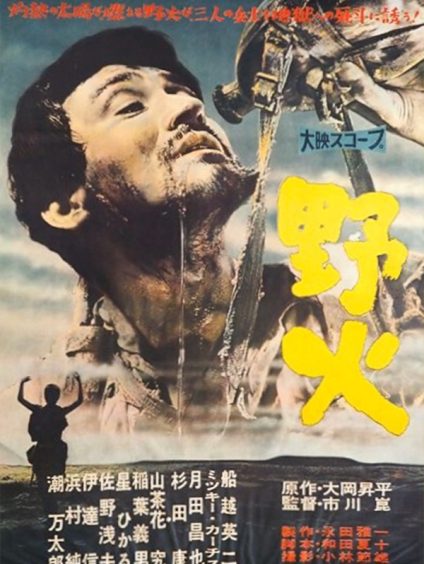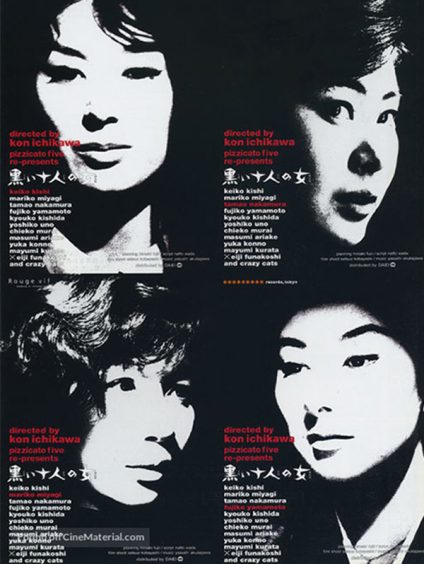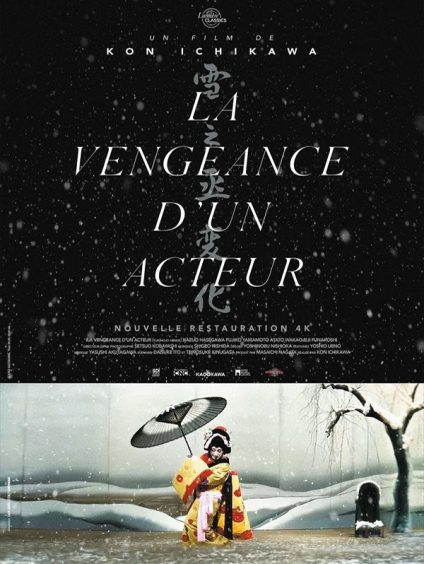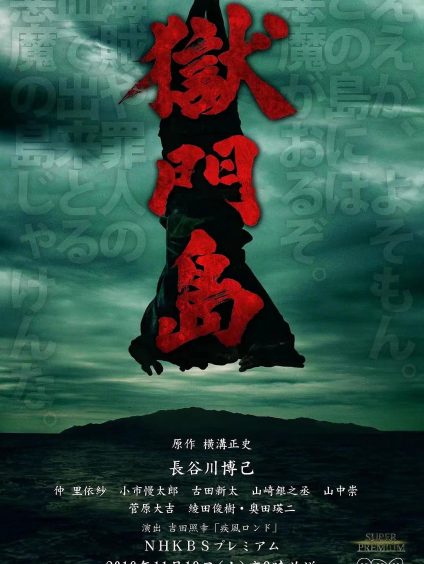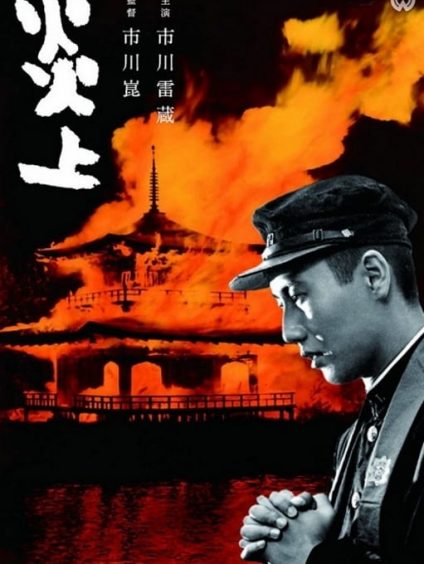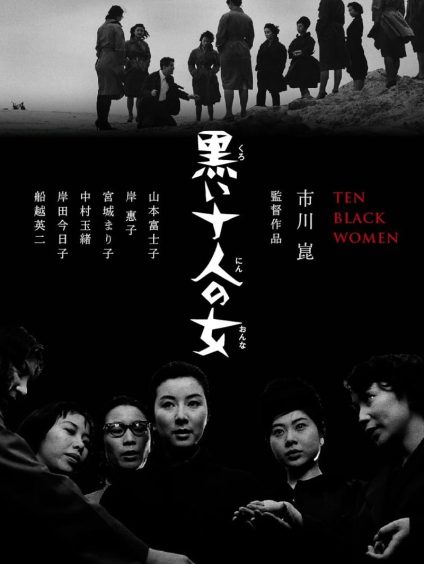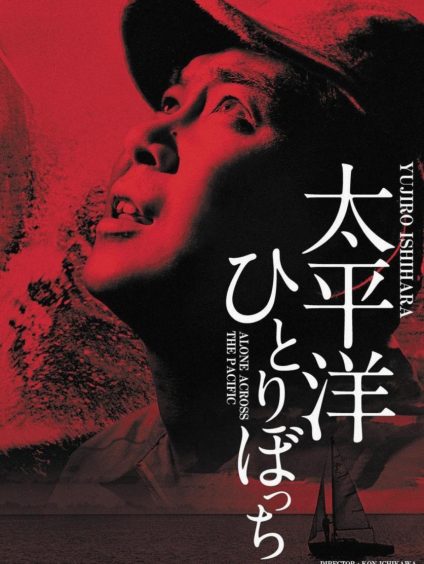Kon Ichikawa
Kon Ichikawa est né le 20 novembre 1915, à Ise, nouveau nom de Ujiyamada dans la préfecture de Mie, et meurt le 13 février 2008 dans sa ville natale, c’est l’un des plus célèbres réalisateurs japonais.
En 1933, après des études de commerce à Osaka1, Ichikawa trouve un emploi dans la section animation de la société Jenkins-Osawa, à Kyoto, où il devient ensuite assistant de réalisateurs. Au début des années 1940, les studios Jenkins-Osawa fusionnent avec les sociétés de production Tōhō et Photo Chemical Laboratories (P.C.L.). Ichikawa rejoint Tokyo à cette occasion. Il y rencontre Natto Wada, alors traductrice pour la Tōhō, qui devient sa femme et écrit les scénarios de la plupart de ses films réalisés entre 1949 et 1965. En 1946, la Tōhō lui donne l’occasion de réaliser un premier film, « La Fille du temple Dojo », une animation tournée avec des marionnettes et adaptée d’une pièce de bunraku.
Kon Ichikawa ne présente pas le script du film au comité de censure de l’occupant américain avant de le réaliser, en conséquence, les autorités américaines confisquent les bobines, empêchant la diffusion du film qui, longtemps perdu — on l’a cru détruit — est désormais retrouvé et conservé, notamment par la Cinémathèque française. Le contrôle et la censure des médias par les forces d’occupation avaient des effets très sensibles sur l’industrie cinématographique japonaise, et se traduisirent notamment, dans l’immédiat après-guerre, par une montée en puissance des syndicats et l’apparition de conflits sociaux dans les sociétés de productions.
Fondé le 5 décembre 1945 (seulement quatre mois après la fin de la guerre) le syndicat de la Tōhō est alors l’un des plus actifs et organise d’importantes grèves et manifestations dès début 1946. À partir de l’automne 1946, un mouvement de grève plus radical provoque une scission parmi les employés de la Tōhō et aboutit à la création en mars 1947 d’une nouvelle société de production sous la bannière anticommuniste, la Shintōhō. S’étant opposé aux grévistes, Kon Ichikawa rejoint la Shintōhō. Ce parti pris n’était pas sans conséquences pratiques : il était à l’abri des « chasses aux sorcières » anticommunistes (qui commencèrent en 1948 lorsque les Américains changèrent radicalement leur politique à cet égard), mais se trouvait désormais dans une société de production sans grands moyens financiers, privée de « tête d’affiche » (comme Mikio Naruse et Akira Kurosawa, qui étaient restés à la Tōhō) et qui se trouvait par conséquent contrainte de produire un cinéma grand public. C’est pourquoi, jusqu’au début des années 1950, Ichikawa est contraint à la réalisation de films à vocations plus commerciales qu’artistiques.